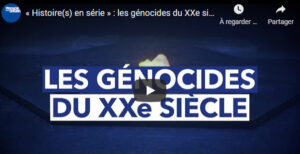Selon le CLEMI, le terme anglais fact-checking, littéralement « vérification des faits », désigne un mode de traitement journalistique, consistant à vérifier de manière systématique des affirmations de responsables politiques ou des éléments du débat public.
« Ce mode de traitement journalistique s’est imposé en France depuis une dizaine d’années, suivant son développement aux États-Unis. À l’origine, le terme désignait un processus de vérification interne dans les organes de presse anglo-saxons. Les journaux avaient dans leur sein (et continuent d’avoir) des employés dont le travail était de vérifier l’exactitude des faits, chiffres ou citations rapportés par les journalistes de terrain. Une forme de contrôle interne de la rigueur de l’information. Mais depuis une quinzaine d’années, le terme désigne une pratique consistant à vérifier de manière systématique les éléments du discours politique, et plus largement du débat public. Un certain nombre de journaux ont mis en place des structures dédiées, notamment en période électorale. Avec l’explosion d’Internet, des sites spécialisés ont vu le jour. Un des premiers fut factcheck.org, site non-partisan et à but non-lucratif. Sa mission revendiquée pourrait résumer le credo des fact-checkers : clarifier le débat public en vérifiant et corrigeant les assertions trompeuses ou confuses. En France, le site d’observation des médias «Arrêt sur Images» fut un des pionniers du genre. Puis Libération et Le Monde, avec respectivement les rubriques «Désintox» et le blog «Les Décodeurs», lancèrent à la fin des années 2000 des espaces entièrement consacrés à la pratique, dédiant des journalistes à cette seule tâche. L’élection présidentielle de 2012 fut le cadre d’une quasi-généralisation de ces rubriques dans l’ensemble des médias français, dans la presse écrite, mais aussi sur les radios et à la télévision. Désormais, certains journalistes ont pour seule fonction de procéder à une écoute exhaustive des déclarations politiques et à en vérifier aussi systématiquement que possible la teneur.
Depuis, la pratique du fact-checking s’oriente dans deux directions. L’émergence des réseaux sociaux et le rôle qu’ils jouent dans l’information ont poussé les fact-checkers à étendre leur veille sur la Toile. Désormais, le fact-checking consiste aussi à sortir du champ de la parole politique pour aller débusquer les rumeurs et fausses informations véhiculées sur le Net. Dans le même temps, le fact-checking a aussi été touché par l’exigence de réactivité que s’assignent les médias en général. Ainsi, des expériences de vérification en live ont été tentées dans des émissions politiques à la télé, des journalistes étant en charge de vérifier en direct les déclarations des invités. De leur côté, les journalistes en charge du fact-checking dans les médias ont désormais coutume de procéder sur le réseau Twitter, en direct, à des vérifications des propos énoncés lors de ces mêmes émissions ou débats politiques. La phase suivante de cette évolution est l’automatisation du fact-checking, souhaitée et expérimentée par certains. En 2013, le Washington Post a ainsi présenté son Truth Teller, un logiciel robot, qui transcrit en temps réel les discours politiques et les compare avec le stock de vérifications déjà effectuées par les journalistes. Des projets similaires sont aujourd’hui à l’étude, au sein de journaux comme Le Monde.
Un paradoxe se dessine toutefois : alors que la pratique du fact-checking s’est institutionnalisée, est l’objet de cours dans les écoles de journalisme, et a pris une grande place dans le débat public, son efficacité est régulièrement questionnée. Les dernières élections ont montré que les vérifications échouent le plus souvent à détourner les responsables politiques de leur propos erronés ou mensongers. Et surtout, le fact-checking se voit reprocher, par une partie des citoyens, sa prétention à dire le vrai, critique de plus en plus commune à l’endroit des médias en général. »
Texte de Cédric Mathiot, journaliste, responsable de la rubrique Désintox, Libération.