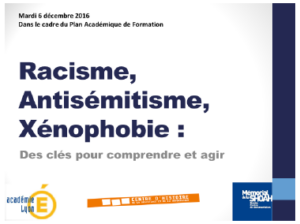D’après le Cambridge Dictionary, la cancel culture est définie comme « une façon de se comporter dans une société ou un groupe, en particulier sur les réseaux sociaux, dans laquelle ou lequel il est courant de rejeter complètement et d’arrêter de soutenir quelqu’un parce qu’il a dit ou fait quelque chose qui vous offense ». Ce mouvement, né aux Etats-Unis, consiste donc à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d’actions, comportements ou propos perçus comme problématiques.
Si dans un premier temps, ce phénomène est né dans la continuité de mouvements sociétaux libérateurs comme le mouvement « #Me Too » qui a donné la parole aux femmes d’une part, et « l’affaire Harvey Weinstein », mettant en cause le producteur hollywoodien pour ses agressions sexuelles, il a ensuite pris une toute autre ampleur notamment dans la vague de déboulonnage de statues de certaines figures du passé liées à la colonisation et à l’esclavage.
France Info, dans son article « Qu’est-ce que la « cancel culture », qui fait souvent polémique sur les réseaux sociaux ?« , propose une définition simple de ce mouvement tout en en dressant un rapide historique.

France Culture, dans « Comment la « cancel culture » se développe tardivement en France« , revient sur les mécaniques qui ont exporté cette tendance de fond des Etats-Unis vers l’Europe, et particulièrement en France, lors notamment des manifestations contre le réalisateur Roman Polanski à l’occasion de la sortie de son film « J’accuse » en 2019.

https://www.franceculture.fr/societe/comment-la-cancel-culture-se-developpe-tardivement-en-france
Franc culture, toujours, et pour aller plus loin, se demande finalement si la cancel culture ne serait pas une nouvelle tyrannie. En effet, « importé des Etats-Unis, terre d’élection d’une nouvelle vague de penseurs combattifs, rattachés à divers mouvements (anticolonialistes, antiracistes, féministes, anti-homophobes, anti-appropriationnistes…), le mot « cancel culture » résonne aussi en France. Hystérisés par des modes de conflit comparables bien qu’à des échelles différentes, à l’image de la question des violences policières, racistes et sexistes, les deux pays sont traversés par une ligne de fracture politique qui renvoie à une certaine éthique de la conversation et du débat public. La « cancel culture » serait ainsi le nom d’un nouveau champ de bataille où les combattants s’affrontent autant sur la forme des désaccords que sur le fond qui les sous-tendent. »

Enfin, dans l’article « Ce que la damnatio memoriae, cancel culture de la Rome antique, nous dit sur l’après-Trump« , Robyn Faith Walsh montre qu’en souhaitant effacer de l’histoire certaines personnalités, les Romains ont fait tout le contraire, allant jusqu’à finalement construire le mythe de ceux qu’ils voulaient supprimer de la mémoire collective.