À propos de : Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914, La Découverte.
A l’instar des mitrailleuses, les appareils Kodak permettent de célébrer la « modernité » occidentale. Mais jusqu’à quel point la photographie montre-t-elle la violence européenne en Afrique et en Asie ?
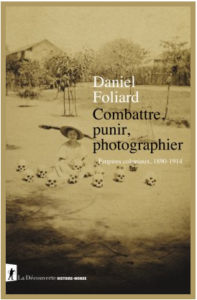 Daniel Foliard a recherché, localisé, trouvé, collecté et, enfin, sélectionné, parmi des centaines de milliers de photographies, un certain nombre de clichés qui, tout en documentant les violences coloniales britanniques et françaises, témoignent aussi de l’évolution des sensibilités des deux sociétés à l’égard de celles-ci. Progressivement, mais de façon croissante au début du XXe siècle, les sociétés européennes ont été de plus en plus exposées aux images de violence en colonies.
Daniel Foliard a recherché, localisé, trouvé, collecté et, enfin, sélectionné, parmi des centaines de milliers de photographies, un certain nombre de clichés qui, tout en documentant les violences coloniales britanniques et françaises, témoignent aussi de l’évolution des sensibilités des deux sociétés à l’égard de celles-ci. Progressivement, mais de façon croissante au début du XXe siècle, les sociétés européennes ont été de plus en plus exposées aux images de violence en colonies.
Sans surestimer l’impact de la presse sur les sociétés de la Belle Époque, c’est cette économie visuelle faite de circulations d’images, d’usages et d’imaginaires fabriqués que l’auteur questionne tout au long de son ouvrage, en croisant systématiquement expériences britannique et française.
S’agissant de la violence, que voit-on que l’on s’autorise à montrer, et que voit-on que l’on ne montre pas ? La photographie a-t-elle rendu perceptible la violence européenne en Afrique et en Asie ? Ou bien l’a-t-elle filtrée, déformée, censurée, acclimatée ? Autant de questions passionnantes posées dans ce livre.
La photo et son commentaire
À partir des années 1890, sous l’effet des progrès techniques, de la miniaturisation des matériels et de la baisse des prix, la possession individuelle d’un appareil de prise de vues ainsi que la pratique photographique se démocratisent rapidement.
Toutefois, alors que des milliers de voyageurs sillonnent la planète – les soldats fournissant les plus gros contingents –, « les reflets les plus extrêmes de leurs expériences » sont rarement photographiés. Pour ce livre, Foliard fait sciemment un pas de côté, en choisissant d’isoler parmi son imposant corpus « les clichés discordants sur la violence qui enveloppe les conflits extra-européens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ».
D’emblée, l’auteur énonce que toute vue, aussi horrible soit-elle, ne doit en aucune façon être séparée de son commentaire. Aussi resitue-t-il et commente-t-il avec soin chacune des images reproduites. Très vite, et avant même de considérer ce que les images montrent, l’acte photographique est abordé en tant qu’« élément de l’arsenal colonial », participant de l’entreprise de domination des territoires et des corps.
Au même titre que l’armement, l’appareil photographique constitue un marqueur de la modernité et de la puissance occidentales. Tout à la fois outil d’autoglorification pour les auteurs/spectateurs d’exécutions des chefs « rebelles » et de propagande à destination des populations devant être soumises, la pratique du trophée photographique se banalise. Les vues s’accompagnent de l’humiliation et de la terreur recherchées du vaincu racialisé, qu’il s’agit de conquérir et de soumettre, encore et encore.
Toutefois, l’incertitude demeure sur les effets véritables des châtiments sur les populations conquises : s’agit-il d’un retour à l’ordre colonial ou d’un témoignage d’une résistance indomptable ?
Célébrer la surpuissance occidentale
Toutes les armées coloniales pratiquent la communication photographique. Les clichés circulent d’une métropole impériale à l’autre ; les principaux opérateurs s’imitent. Très vite aussi apparaît l’idée que l’on ne saurait tout montrer aux publics métropolitains. Un subtil jeu s’exerce pour rendre visible l’expansion coloniale en métropole sans y provoquer pour autant de scandale visuel et politique inopportun.
À partir de 1895, la colonisation de Madagascar permet aux officiers français de structurer de façon plus systématique et plus raisonnée – contrôlée – la production d’images de la conquête. Dès 1896, Gallieni achève de placer la photographie au service de la colonisation de la Grande Île.
De leur côté, au Soudan, les Britanniques immortalisent leurs combats forts inégaux contre les troupes « fanatiques » mahdistes, menés à grand renfort de mitrailleuses et d’appareils Kodak. Là encore, célébration de la surpuissance blanche et occidentale ; célébration aussi de la modernité et de la technique, qu’il s’agisse du combat ou du mode industriel d’affirmation et d’immortalisation de la supériorité européenne. Avec la guerre au Transvaal, les Britanniques resserrent leur contrôle de la production et de la circulation des images. Les censeurs y font aussi leurs débuts.
Dans le même temps, les usages humanitaires de la photographie se banalisent. Ainsi les atrocités belges au Congo font l’objet d’une dénonciation visuelle internationale. On sait que la dénonciation des « mains coupées » sera d’ailleurs – injustement – retournée contre les Allemands lors de leur invasion brutale de la Belgique en août 1914.
On note par ailleurs que tous les ennemis ne sont pas traités de la même manière. Il est aussi plus facile d’exhiber la violence des concurrents. Enfin, ce qui est montrable dans le sud de l’Afrique ne l’est pas à Londres. D’où la possibilité d’esquisser une géographie des visualisations. Mais n’avons-nous pas affaire à une géographie en trompe-l’œil ? L’auteur note que « les images les plus dures des manifestations de la force n’apparaissent pas partout ».
Aussi ne disposons-nous d’aucune image des violences commises en Australie contre les populations indigènes. La relative invisibilité des « dérapages » les plus choquants, dans la documentation officielle, témoigne de la pleine conscience des autorités des effets de l’image sur l’opinion et de l’efficacité des filtrages opérés par les forces de conquête, de gouvernement ou de police.
Un apprentissage de la violence ?
À partir de 1907, même si l’on retrouve des processus analogues concernant la Namibie allemande ou les Indes britanniques, la campagne engagée par les Français pour la conquête du Maroc est particulièrement bien documentée – jusqu’aux horreurs les plus extrêmes. Elle participe de ce point de vue d’un nouveau tournant dans l’élargissement du périmètre de la publicisation de la violence de guerre, une manière d’attester à la face du monde des capacités de destruction de l’armée française. Et ce, d’autant que de nombreux clichés sont reproduits et largement diffusés sous la forme de cartes postales.
La photographie des horreurs est-elle un média d’apprentissage de la violence de la guerre moderne ? La réponse ne va pas de soi. Il reste que ses modalités et ses ravages sont parfaitement documentés et largement donnés à voir, à l’occasion des différents conflits précédant la Grande Guerre. Au tournant du siècle, il semble que la pudeur vis-à-vis des morts européens s’estompe. Pourtant, force est d’admettre avec Foliard que, si beaucoup ont vu, peu ont regardé :
Le cliché de l’indifférence face à la photographie atroce circule déjà à la fin du XIXe siècle. L’idée d’une Belle Époque goulue de nouvelles atrocement illustrées, voyeuriste et prête à la guerre est ainsi fragilisée. (p. 379)
Se pose alors une question : en quoi la violence en terrain colonial diffère-t-elle de la violence politique et militaire « ordinaire » ? Foliard assure qu’« en situation coloniale et dans nombre des conflits extra-européens de l’époque, la violence est débordante. […] La force imposée aux corps dépasse les limites de la guerre ».
Effectivement, la violence déborde, mais est-ce à dire qu’en métropole ou dans les conflits européens, la violence ne déborderait pas ? Sur un plan général, ne peut-on s’accorder sur le fait que les limites posées à la guerre sont systématiquement repoussées, dès lors qu’une armée – occidentale en l’occurrence –, richement armée, mène une guerre irrégulière et asymétrique contre une population largement civile, désarmée ou possédant un armement plus que rudimentaire, aussi bien hors d’Europe qu’en Europe même ? L’écrasement militaire de la Commune de Paris, par exemple, appartient à cette longue série sans fin. Cela pourrait justifier que soit préférée la notion de violences en colonies plutôt que celle de violences coloniales. Cela permettrait de penser le continuum empires-métropoles, et inversement.
Images « insensées »
Quid également de la violence symbolique « ordinaire » ? Ce n’est qu’à la fin de l’ouvrage (p. 396) que l’auteur évoque les « images manquantes », celles de la « violence lente, ordinaire, de violence structurelle, l’effet des famines ». Cela constitue, à mon sens, le principal angle mort de ce livre, par ailleurs remarquable de précision, de nuance et de tact.
Précisément, questionnons pour finir l’un des partis pris de l’auteur. Celui-ci insiste sur le caractère sélectif de sa collection et, fort justement, son premier critère tient au lien qu’il importe d’établir entre le cliché et d’autres archives permettant de contextualiser l’image et les conditions de sa fabrication, puis de sa conservation. Ce lien est ici bien noué.
Mais le second critère retenu est plus discutable. En effet, l’auteur se dit pleinement conscient que nombre de ces images peuvent choquer, émouvoir, « imposer des sentiments ». Sans aucun doute. Au point d’« aveugler » parfois le lecteur, soutient-il avant de regretter encore que certaines de ses images soient impossibles à neutraliser. Plus encore, le fait que « la sélection exposée ici [soit] pesée à l’aune de ce que l’on considère comme acceptable ou trop choquant » aujourd’hui pose question.
De même, l’affirmation selon laquelle « certaines images trop insensées ne figurent pas dans le livre » (p. 17) est assez déroutante. Car qu’est-ce qu’une image « trop insensée » ? Ce qui se joue là, c’est rien moins que la question du statut de l’archive. Toute société a recours à des processus d’iconisation, et, si risque il y a, c’est à mon sens dans les mésusages éventuels des images iconiques.
Je peine à imaginer une telle euphémisation pour ne pas rendre compte, par l’image, de la destruction du ghetto de Varsovie ou de la libération des camps de la mort. Quelles sensibilités s’agirait-il de ménager ? Pourquoi faudrait-il « désarmer » l’image-choc « plutôt que la subir », comme énonce la quatrième de couverture ?
Quant à l’argument selon lequel « celui qui reproduit l’image [s’inscrirait] dans le circuit de la violence qu’il pourrait s’appliquer à rompre », il est difficile d’y souscrire. Je soutiens, au contraire, que subir et « faire subir » une image-choc, c’est en définitive enclencher l’un des déclics indispensables pour penser le et la politique de nos passés. Pour agir, ici et maintenant.
Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914, Paris, La Découverte, 2020, 455 p., 23 €.
par Frédéric Rousseau, le 5 juillet, https://laviedesidees.fr/Foliard-Combattre-punir-photographier.html
